-
 Marc Jacquemain,
Marc Jacquemain,
sociologue
Quel avenir pour le travail ?
(texte réduit)

Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Il n’est pas possible aujourd’hui de parler des inégalités sociales sans s’interroger sur le sens du travail. En effet, la figure contemporaine de l’inégalité, en tout cas – au sein des sociétés développées –, c’est en priorité l’exclusion sociale. Et l’exclusion, on le sait, commence en premier lieu par la privation de travail.
Cette idée se retrouve d’ailleurs dans le petit texte qui a été proposé aux différents rédacteurs de ce numéro afin de susciter leur réflexion : « Seule source de reconnaissance sociale, d’acquisition de la dignité et de construction du sens de la vie, le travail pourrait-il devenir à vos yeux une notion dépassée ? ». À cette question je ne vois qu’une réponse raisonnable : « Je l’espère. »
En effet, la question, y compris dans le côté excessif de sa formulation, exprime bien une des contradictions des sociétés occidentales d’aujourd’hui : c’est au moment où, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, la pérennité du travail comme mode de participation sociale ne paraît plus totalement garantie qu’on investit symboliquement le plus dans ce qu’il représente. Notre société a, selon la belle formule de Dominique Méda1 « enchanté le travail », c’est-à-dire qu’elle l’a chargé de la quasi-totalité de ses « énergies utopiques ». Cette contradiction a des effets sociaux dévastateurs. Faire du travail la valeur cardinale de notre société, au moment même où il devient si difficile, pour certains, de trouver à travailler, est tout saut innocent. Cela conduit en premier lieu à culpabiliser ceux qui n’ont pas de travail et qui se sentent ainsi plus ou moins désignés comme des « parasites ». En second lieu, cela permet de faire pression sur ceux qui en ont un et pour qui le pire serait de le perdre, ce qui contribue assurément à les rendre moins regardants sur les conditions auxquelles ils vendent leur travail.
(…) c’est au moment où, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, la pérennité du travail comme mode de participation sociale ne paraît plus totalement garantie qu’on investit symboliquement le plus dans ce qu’il représente.
Si l’on y réfléchit bien, cette « obsession du travail » si caractéristique de nos sociétés contemporaines apparaît a priori assez absurde au regard de la notion même de progrès telle que nous l’avons héritée de la philosophie des Lumières. Car, au fond, qu’est-ce que le progrès, sinon la possibilité pour l’humanité d’assurer sa subsistance matérielle en y consacrant le moins d’efforts possibles ? (…)

Prenons les choses par un autre bout : qu’est-ce que le progrès technique sinon la possibilité croissante d’économiser le travail humain ? (…) De manière générale, tout progrès technique est toujours une façon de faire davantage de choses avec le même temps de travail ou la même chose avec moins de temps2. Dès lors, on voit bien que l’on est devant une contradiction fondamentale : comment peut-on faire une valeur centrale du travail et reconnaître en même temps que le progrès consiste à l’économiser le plus possible3 ? Comment peut-on faire une valeur fondamentale de quelque chose dont on cherche à réduire autant que possible la place dans notre vie ?
(…) comment peut-on faire une valeur centrale du travail et reconnaître en même temps que le progrès consiste à l’économiser le plus possible3 ? Comment peut-on faire une valeur fondamentale de quelque chose dont on cherche à réduire autant que possible la place dans notre vie ?
Pour comprendre le paradoxe, il faut partir d’une idée de base : la plupart du temps, lorsque nous parlons de la place du travail dans la société et dans la vie humaine en général, nous utilisons le même mot pour désigner des réalités différentes et qui ne se recoupent pas nécessairement.
Le mot « travail » désigne au moins trois choses différentes. En premier lieu, c’est la contribution de chacun à la production sociale, en échange de quoi, il reçoit ses moyens de subsistance. On évoque alors le travail, en somme comme « facteur de production », pour employer le langage des économistes. En second lieu, c’est un mode privilégié de participation au réseau de relations sociales qui constitue notre intégration dans la société et nous y confère un statut. C’est alors le travail comme « emploi ». Enfin, c’est un mode particulier de relation au monde extérieur, à travers lequel nous nous exprimons et nous nous réalisons. On pourrait appeler cela le travail comme « œuvre ».
Le problème fondamental est qu’il n’y a pas nécessairement correspondance entre le travail comme facteur de production, le travail comme emploi et le travail comme œuvre. Ou, pour le dire dans les termes de l’économiste français Alain Lipietz4, un des théoriciens des « Verts », il n’y a pas nécessairement correspondance entre les trois fonctions du travail, qui sont d’assurer un revenu , une reconnaissance sociale et une forme d’estime de soi.
Il est vrai que, dans nos sociétés, le travail reste au centre du lien social mais cela ne suffit pas à justifier toutes les formes d’occupation : faire faire aux gens n’importe quoi n’est pas nécessairement préférable au chômage, surtout dans la durée.
(…) investir le travail de tous nos « espoirs utopiques », c’est s’empêcher de réfléchir, à plus long terme, sur la manière de réduire l’aliénation au sein de nos sociétés, en diversifiant les formes de construction tant de la reconnaissance sociale, que de l’estime de soi.
En conclusion, une chose est de reconnaître que le travail est aujourd’hui — et sans doute encore pour un certain temps — le premier facteur de lien social et donc que, pour n’exclure personne de ce lien, il est essentiel de répartir le mieux possible le travail existant ; une autre chose est de faire du travail un idéal pour toute société possible en le définissant comme « seule source de reconnaissance sociale, d’acquisition de la dignité et de construction du sens de la vie ». Je pense au contraire qu’investir le travail de tous nos « espoirs utopiques », c’est s’empêcher de réfléchir, à plus long terme, sur la manière de réduire l’aliénation au sein de nos sociétés, en diversifiant les formes de construction tant de la reconnaissance sociale, que de l’estime de soi.
- Dominique Méda (1995) : Le travail, une valeur en voie de disparition, Paris, Hachette, coll. Pluriel.
- Dans de nombreuses circonstances, bien sûr, le progrès technique élargit également la gamme de ce qu’il est possible de faire. Par exemple, la télévision ou l’ordinateur. Mais on peut aussi les voir comme des économiseurs de temps en matière de communication.
- Question qui est au fond celle que pose André Gorz à travers tous ses ouvrages depuis le début des années 80 : Adieu au prolétariat (1961), Métamorphoses du travail – Quête du sens (1986) et Misère du présent, richesse du possible (1995).
- En disant cela, Lipietz suppose implicite ment que le travail comme « facteur de production » et que le travail comme « moyen de gagner sa vie » sont une seule et même chose. Or précisément, une des discussions les plus importantes aujourd’hui est de voir s’il n’est pas utile de découpler— au moins partiellement—les deux aspects : c’est notamment toute la question de l’allocation universelle, que je n’aborde pas dans le cadre de ce petit texte. Merci à Michel Laffut d’avoir attiré mon attention sur ce « glissement sémantique ».
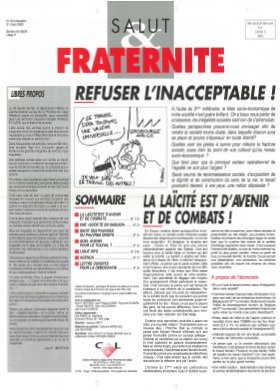
Publié dans Salut & Fraternité n° 32, Refuser l’inacceptable, 31 mars 2000, p.4.

Robert Moor
Président (Depuis 2015)
La vie ne se résume pas au travail, Marc Jacquemain en parlait bien, mais je pense que l’emploi est une notion importante. Il permet de gagner sa vie, de trouver un réseau social où s’épanouir. Il reste ainsi pour moi un élément essentiel dans la vie de chacun. Et quand la retraite sonne, il est encore possible de « travailler » bénévolement au sein d’une association telle que le CAL et de s’y épanouir. « Se creuser les méninges », penser, écrire, lire, dessiner, découvrir, c’est aussi une autre manière de considérer le terme travail, davantage centré sur soi-même.
Pour en revenir au travail dans son acception classique, le drame, ce sont les nombreuses personnes qui en sont privées et qui sont poussées à la marge de notre société. Les pistes de solution existent pourtant afin de permettre à tous de disposer des bases pour vivre dans la dignité au sein d’une société solidaire : la réduction du temps de travail avec embauches compensatoires, l’allocation universelle en font partie.
Aussi, à l’heure où la question de l’austérité budgétaire prend de plus en plus d’ampleur, il est sain de se questionner sur la mise à mal de notre système de sécurité sociale alors que l’évasion fiscale, voire la fraude, est devenue un sport national et international, privant la collectivité de nombreux leviers de redistribution.
Le CAL a réfléchi et débattu sur le sujet à de nombreuses reprises. Lors de rencontres-débats, de matinées de réflexion, de conférences et d’animations, il défend la solidarité comme l’une des valeurs cardinales de son action. Pour aller en ce sens, l’exposition En Lutte. Histoires d’émancipation, inaugurée en 2016, nous explique comment la solidarité ouvrière s’est imposée dans un contexte de grand développement économique en Wallonie.
Ces questions prennent une dimension particulière au regard des inégalités criantes au niveau international. L’actualité nous montre encore les conditions de travail effroyables, notamment dans le monde du textile, auxquelles sont soumis les travailleurs. La laïcité organisée continue ainsi à réfléchir sur cette question et à imaginer des pistes pour que chacun, au sein de la société mondialisée, puisse être respecté dans son travail. L’action syndicale au niveau international, l’établissement de cahiers de charge éthiques pour l’entrée des produits, les campagnes de presse dénonçant les abus, la mise en avant du commerce équitable constituent quelques-unes des pistes à développer au sein de notre pays pour rendre sa dignité au travail de tous les citoyens du monde !

