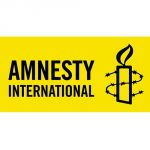-
 Mounir Fatmi,
Mounir Fatmi,
artiste plasticien et co-auteur du livre Ceci n’est pas un blasphème
Le Blasphème, faut-il en rire ou en pleurer ?
D’abord il y a une image qui me vient en tête?: celle de ce manifestant à Alger, le vendredi 16 janvier, qui brandit avec rage un grand papier « Je suis Mohamed », écrit en français et en arabe, qui reprend sur fond noir, l’esthétique des pancartes « Je suis Charlie » de la manifestation parisienne du 11 janvier. C’est le comble de l’ironie?: en criant ainsi sa colère contre le blasphème de la caricature de Mohamed en une de l’hebdomadaire, ce fondamentaliste ne réalise pas qu’il commet un blasphème mille fois plus terrible?! Il se met lui, simple mortel, à la place du Prophète censé incarner l’unicité de l’islam.
Car c’est vrai, ni le Coran ni aucun autre texte fondateur de l’islam ne formulent d’interdiction claire et nette de représenter le prophète. Le Coran, en revanche, se prononce contre les idolâtres, qui vénèrent images et autres statues, mais à une seule reprise?: « Le vin, les jeux de hasard, les idoles sont des abominations inventées par Satan. Abstenez-vous en » (Sourate V, verset 901).
L’enjeu, pour la religion musulmane naissante était d’une part d’imposer son monothéisme contre tous les cultes païens et les divinités du monde préislamique, d’autre part de se différencier du culte catholique, en particulier orthodoxe dans la civilisation byzantine, qui s’appuie fortement sur ses icônes. Les interrogations sur la représentation, non seulement des figures de l’islam mais de tout animal ou être humain, apparaissent, dès l’origine, plus politiques que strictement religieuses. L’interdiction de toute représentation du prophète est récente, et témoigne d’une lente radicalisation politique depuis environ un tiers de siècle.
Je me sens plus un témoin qu’un vrai spécialiste de l’islam. Je l’analyse d’abord sous le prisme de l’image, en tant qu’artiste contemporain. J’ai vécu la plus grande partie de mon enfance et de mon adolescence à Casablanca. Jusqu’à mes dix-huit ans, jamais je n’ai eu l’impression que la religion posait problème dans le quotidien des Marocains. Dans mon quartier, on savait qui pratiquait ou non le Ramadan, qui respectait ou non scrupuleusement ses moments de prière, mais personne ne s’en préoccupait.
L’islam était vécu de façon intime, il s’arrêtait à la sortie de la mosquée. C’est à la fin des années 1980 que l’ambiance a commencé à changer, et que j’ai senti peu à peu une radicalisation chez certains, transformant une question personnelle, à savoir la pratique de l’islam, en un enjeu également politique et social.
Que certains religieux fondamentalistes se sentent blasphémés dans leur foi par des œuvres et caricatures, c’est impossible de le nier. En revanche, quelle que soit leur sincérité, ce sentiment me semble fabriqué et entretenu par certains, pour des raisons politiques bien plus que spirituelles.
- « Dans quelles conditions l’islam autorise-t-il la représentation du Prophète ? », par Louis Imbert, Le Monde, 15 janvier 2015. http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/01/15/dans-quelles-conditions-l-islam-autorise-t-il-la-representation-du-prophete_4557365_4355770.html.