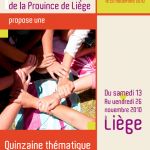-
Alain Lapiower,
Lezarts urbains
Slam : le grand retour de la prise de parole
Lezarts Urbains est une association centrée sur les cultures urbaines. Elle tente de valoriser des formes artistiques vivantes et originales telles que la danse urbaine, le rap, le slam, l’art graffiti ainsi que toutes les disciplines apparentées.
Le « slam » a la cote ces dernières années. Signe de son succès et celui de ses soirées, l’association est de plus en plus souvent appelée pour assurer des animations dans les écoles, en maisons de jeunes, en alphabétisation, en prison, en centre culturel, en bibliothèques… C’est ainsi qu’il rencontra même une relative attention de la part des milieux « littéraires », même si cette dernière est plutôt condescendante.
(…) dans les écoles du bas de la ville de Bruxelles par exemple, c’est bien le rap et non le slam qui a provoqué cette envie d’écriture de la part des gamins, qui s’identifient bien plus volontiers à Booba ou Medine qu’à un Grand Corps Malade un peu trop gentillet. Mais peu importe, car l’essentiel est qu’un vent d’écriture souffle aujourd’hui, et que cette motivation permet bien des ouvertures.
Dans le contexte difficile contemporain qui entoure la lecture et l’écriture pour les publics jeunes et encore plus pour les jeunes de milieu populaire, l’idée d’amorcer une réconciliation via le slam fit son chemin au sein de Lezarts Urbains. Sans vouloir bâtir des constructions excessives sur de simples intuitions et sur une mode, il nous est en tout cas apparu qu’on pouvait pour le moins tenter quelques expériences à partir de cet élan d’intérêt.
L’ouverture du cadre scolaire par exemple, notamment dans les quartiers « difficiles », est une opportunité à saisir même si elle ne correspond pas nécessairement à ce que de nombreux enseignants veulent croire. Car dans les écoles du bas de la ville de Bruxelles par exemple, c’est bien le rap et non le slam qui a provoqué cette envie d’écriture de la part des gamins, qui s’identifient bien plus volontiers à Booba ou Medine (NDLR : rappeurs français) qu’à un Grand Corps Malade (NDLR : slameur français) un peu trop gentillet. Mais peu importe, car l’essentiel est qu’un vent d’écriture souffle aujourd’hui, et que cette motivation permet bien des ouvertures.
L’apport principal d’un atelier slam est avant tout lié à l’oralité
Cet objectif central d’une prise de parole, permet d’emblée de poser la question créative en termes « d’adresse », au sens communicateur du terme. Un processus qui sera donc aussi corporel, à travers la voix, le geste et le corps entier lors de la déclamation. L’effet cathartique, provient non seulement du « face au public », mais aussi et peut-être plus encore, de cette portée intense et libératrice qui doit accompagner un texte à « slamer ». Ce côté communicateur et intense nous paraît essentiel et différencie précisément ce processus de la démarche rédactionnelle ou déclamatoire classique. C’est la notion d’engagement, au sens psycho-personnel d’abord (l’implication est forte, dans l’ici et maintenant) mais aussi dans le social.

Le slam est un « mouvement », il crée du lien et du sens, plaçant le participant au centre d’un cercle mais pas uniquement en tant qu’acteur qui focalise les regards, aussi en tant qu’acteur social, et c’est ce mobile qui nous intéresse. C’est aussi ce qui va motiver des jeunes qui vont se lancer dans un atelier : la sensation de participer non pas à l’apprentissage d’une simple technique d’expression, mais bien à la circulation de la parole dans un courant.
Nous travaillons le plus souvent à partir de contenus, amenés par les participants et puisés dans leur environnement social, à travers des questions qui brûlent les lèvres autour de l’atelier. Il n’est pas rare que des larmes surviennent lors des présentations publiques, tant ces sujets sont « chauds » aujourd’hui1. De quoi nous rappeler que l’émotion est le mobile central de l’écriture, mais combien l’ont oublié ? Cette matière vive permet de nombreuses discussions de fond à caractère édifiant, mais aussi une rencontre authentique entre des personnes qui habituellement ne se « parlent » quasi jamais.
L’apport structurant et psychothérapeutique de cette écriture à haute voix n’est plus à montrer. Mais l’oralité représente aussi un enjeu émancipateur et socialisant de première catégorie pour les milieux populaires et pour toutes les personnes en difficulté avec la « Culture » instituée ou les codes dominants. Parce que c’est la voie royale de la communication et de la transmission dans ces milieux. C’est aussi le cas dans la majorité des cultures traditionnelles encore très vivantes dans les pays et continents d’où proviennent la plupart des personnes issues de l’immigration. L’aisance incroyable dans ce domaine, dont bien souvent les jeunes d’origine immigrée font preuve (la « tchatche »…) a donc un intérêt considérable en termes de valorisation et d’exutoire mais aussi de stimulant pour entrer dans l’univers de l’écriture.
L’atelier de slam apporte par ailleurs quantité d’ingrédients bien nécessaires. Il s’agit d’une véritable aventure en groupe hors des normes. Elle permettra aux uns et aux autres, professeurs ou animateurs compris, de sortir de rôles figés, de lever le voile sur la complexité des personnes et des parcours personnels, bref d’aller vers la vie, vers la pensée non superficielle et vers le monde. N’est-ce pas une des urgences aujourd’hui ?
< Retour au sommaire