-
 Bernard Rentier,
Bernard Rentier,
recteur honoraire de l’Université de Liège et membre de l’Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique
La connaissance scientifique est un bien public
Le droit à la connaissance devrait obtenir le statut de droit humain fondamental en tant que partie intégrante du droit à l’éducation. En effet, ce 20 janvier 2017, nous avons assisté à l’avènement du négationnisme anti-scientifique au pouvoir de la plus grande puissance occidentale. Cette poussée de l’obscurantisme, que l’on attribuait habituellement à des régimes de stricte observance religieuse, doit nous interpeler au plus haut point.
Et pourtant, nous sommes encore loin d’une reconnaissance du savoir comme un bien public, particulièrement dans le domaine scientifique, où la connaissance est produite par la recherche, diffusée par l’intermédiaire de publications qui, comme leur nom l’indique, ont pour but de la rendre publique.
Réexaminons l’Histoire. Les premières publications scientifiques apparaissent au XVIIe siècle sous l’égide de sociétés savantes qui assurent le travail d’édition, d’impression et de distribution. Par la suite, ces sociétés recourent à des sous-traitants spécialisés et ne conservent que l’édition, c’est-à-dire la sélection des articles, l’organisation d’une révision par des pairs (d’autres scientifiques, en principe compétents et loyaux) et la décision finale de publier. Des maisons de publication se créent ainsi et prospèrent, au point de s’approprier la mission d’édition elle-même. En soignant au mieux la qualité de leur travail, certaines d’entre elles vont bénéficier d’un prestige grandissant, lié à la sélection judicieuse des articles publiés.
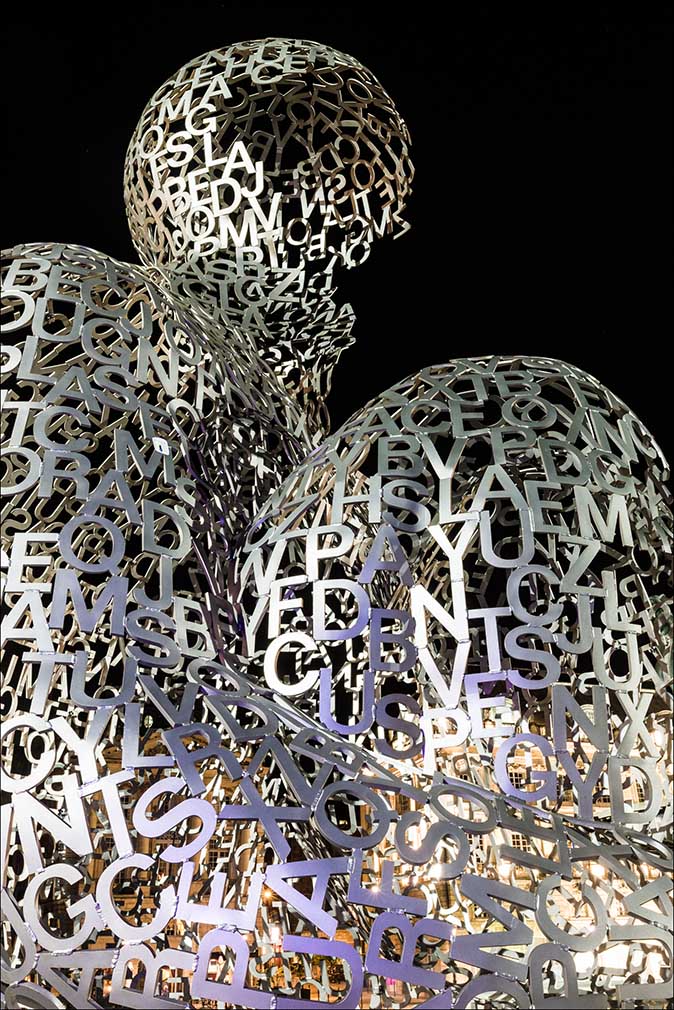
Au XXe siècle, la croissance de la recherche et des moyens qui lui sont attribués transforme l’édition scientifique en un business rentable, juteux même, pour les éditeurs qui grandissent par acquisitions pour former d’immenses consortiums multinationaux dont les chiffres d’affaires se comptent en centaines de milliards de dollars et dont les marges bénéficiaires atteignent 40 % et plus. Ces profits sont d’autant plus déraisonnables qu’ils sont constitués essentiellement à partir de financements publics.
Certes, la diffusion du savoir fait partie de la démarche scientifique, mais à l’heure de l’internet, le volet « diffusion » proprement dit se simplifie considérablement et s’accélère. Aujourd’hui, la valeur ajoutée de l’éditeur se réduit quasiment à la gestion de la révision par les pairs, et rappelons-nous que les pairs sont aussi des chercheurs et qu’ils prêtent leur concours gracieusement. Pour assurer la constance de leurs revenus, les éditeurs scientifiques ont pris en outre l’habitude d’exiger des auteurs l’abandon complet de leurs droits, ce qui assure l’emprisonnement moral et légal du chercheur.
Un bien public est, par définition, universellement accessible, non compétitif et non exclusif, ce qui implique une gratuité d’accès et l’absence de tout frein technique. Les moyens existent aujourd’hui pour remplir ces conditions, avec ce qu’on appelle l’Open Access (OA) ou Accès Libre à l’information scientifique issue de la recherche. Né vers le milieu des années 1990, l’OA s’est organisé durant les années 2000 pour devenir pratiquement incontournable durant la décennie 2010. Même les grands consortiums éditoriaux doivent aujourd’hui admettre que la tendance est devenue irréversible.
Toutefois, l’impératif du profit démesuré et de la rémunération substantielle de l’actionnariat demeure et amène les grands éditeurs à inverser le système et à exiger non plus un paiement pour lire, mais un paiement pour publier. En continuant à tabler sur leur prestige, ils convainquent les chercheurs de publier chez eux, s’assurant ainsi le monopole de l’édition scientifique haut de gamme.
Le combat n’est donc plus tant aujourd’hui de donner une accessibilité gratuite et immédiate à la connaissance jusque dans les contrées les moins favorisées – cette étape-là est déjà un succès – mais d’éviter que seuls des chercheurs fortunés ne puissent s’exprimer.
Le combat n’est donc plus tant aujourd’hui de donner une accessibilité gratuite et immédiate à la connaissance jusque dans les contrées les moins favorisées – cette étape-là est déjà un succès – mais d’éviter que seuls des chercheurs fortunés ne puissent s’exprimer. C’est une évolution consternante et discriminante qui, après avoir rendu la vue à la majorité de la communauté scientifique, la prive en revanche de la parole.
La parade contre cette dérive insupportable est la création de plateformes de publication électroniques publiques et gratuites. De telles initiatives existent aujourd’hui. Il reste à la communauté scientifique mondiale d’y adhérer et de bannir les critères d’évaluation de la recherche et des chercheurs basés sur le prestige des éditeurs. C’est une véritable révolution culturelle qui prendra, hélas, encore du temps avant d’imposer son bon sens.
< Retour au sommaire
