-
 Henri Deleersnijder,
Henri Deleersnijder,
professeur d’histoire et essayiste
Lire, c’est résister
« Quand j’entends le mot culture, je sors mon revolver. » Cette phrase archiconnue, attribuée tantôt à Gœring et tantôt à Gœbbels, résume dans sa brutale concision tout le mépris que les nazis éprouvaient pour la pensée libre et ses expressions les plus nobles. Légèrement adaptée d’une pièce de théâtre intitulée Schlageter – du nom d’un Allemand exécuté en 1923 sur ordre des forces françaises occupant la Ruhr et considéré comme le « premier martyr » du mouvement national-socialiste –, elle est de- venue aujourd’hui emblématique de la haine que l’extrême droite a toujours nourrie pour les créations de l’esprit, du moins quand celles-ci échappent à son carcan idéologique ou à ses funestes machinations.
L’Histoire regorge d’exemples de ces pratiques répressives propres aux régimes autoritaires et totalitaires. Déjà le premier empereur de Chine, Shihuangdi, fait brûler entre 221 et 210 avant notre ère tous les livres des lettrés confucéens, à l’exception des ouvrages de caractère technique. Au Moyen âge, c’est le Talmud qui, dans une Europe christianisée, est livré aux flammes. Et au XVIIIe siècle, alors qu’on la croyait définitivement aveuglée par les Lumières et tapie à jamais dans son antre, la censure aux impitoyables ciseaux parvient encore à interdire en France la publication de l’Encyclopédie. Quelle sinistre continuité historique entre les anciens manuscrits caviardés et les autodafés de l’Allemagne hitlérienne !
On ne peut dès lors que ressentir de l’admiration pour les écrivains qui se sont indignés à la vue de ces meurtrières dérives et ont osé s’élever contre les pouvoirs qui y sombraient. Emile Zola fut de ceux-là. Son célèbre J’accuse, publié dans le journal L’Aurore du 13 janvier 1898, est l’acte de naissance de l’« intellectuel » moderne. Voilà un terme qui charrie d’emblée un sens péjoratif puisque, au moment de l’Affaire Dreyfus, il a d’abord été employé par les opposants du capitaine injustement condamné pour trahi- son afin de stigmatiser ceux qui le défendaient au nom de leur haute idée des droits de l’homme. C’est que les nationalistes de l’époque, plus attachés à l’ordre qu’aux valeurs républicaines, s’étaient donné comme mission de protéger la nation, de l’épurer aussi pour tenir à distance les apports extérieurs, bref de la préserver de tout ce qui était à leurs yeux susceptible de provoquer des lézardes en son sein.
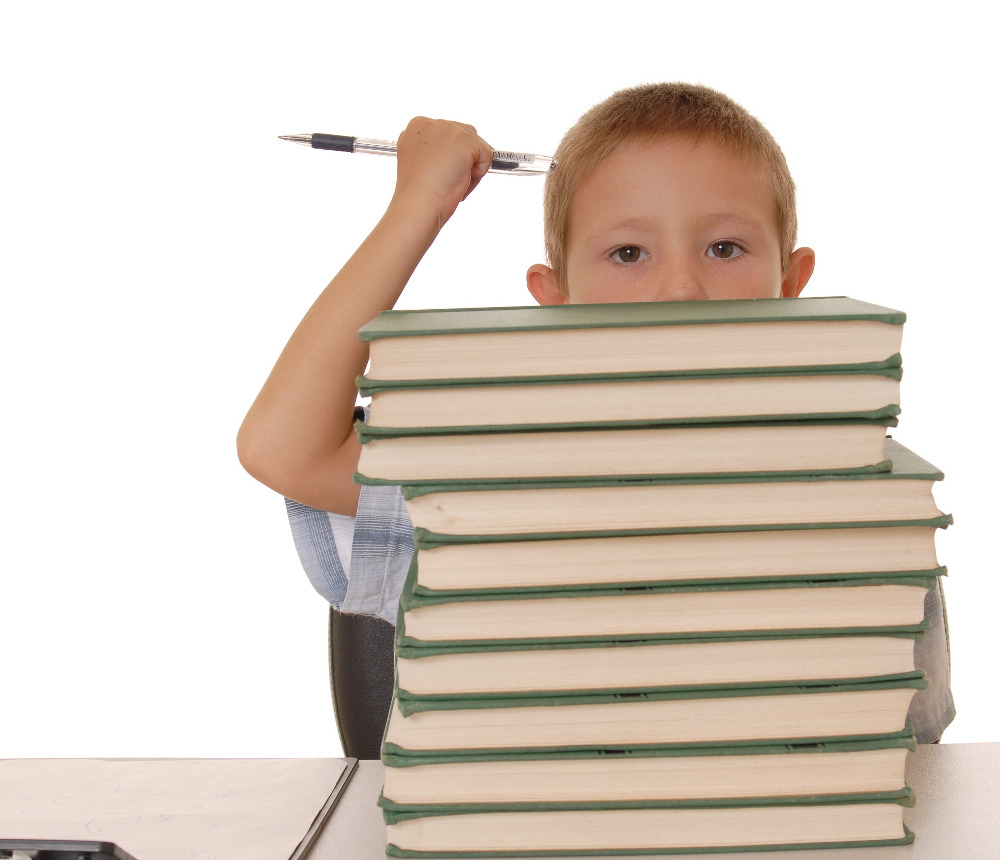
Les temps ont bien changé certes, et il ne peut être question de jouer inutilement à se faire peur : en ce début de XXIe siècle, l’ogre fasciste n’a tout de même pas une nouvelle fois dévoré les démocraties. Et pourtant, en ce qui concerne notre seule Union européenne, il faudrait être particulièrement distrait pour ne pas s’apercevoir qu’un vent mauvais s’y lève. Depuis quelques années, en effet, s’y développent des mouvements populistes – avec d’appréciables résultats électoraux à la clé – dont les thématiques voisinent très souvent avec celles de la droite extrême la plus dure : nationalisme, xénophobie ou racisme, antiparlementarisme, lutte contre toute forme de pluralisme, etc. Cette dangereuse panoplie présente finalement tous les aspects d’un rejet de l’Autre, immigré en tête. Et, dans notre société consumériste aux goûts standardisés, au politiquement correct triomphant, les écrivains et artistes – ces spécialistes de la mobilité culturelle – ne seraient-ils pas des « immigrés » par excellence ? Raison de plus pour leur permettre de s’adonner à leurs créations. Le livre parmi elles, en dépit du succès des nouvelles technologies de communication, reste certainement le meilleur rempart contre le formatage des esprits et un précieux antidote contre les menaces pesant sur la démocratie. Car c’est dans le silence de la lecture que s’échafaude une pensée libre. Et la volonté de penser, c’est aussi résister.
A cet égard, on ne peut qu’adhérer à la ferme résolution du regretté Francis Blanche : « Quand j’entends parler de revolver, je sors ma culture… »
< Retour au sommaire
