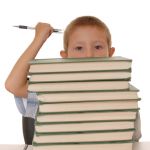-
Céline Martin,
coordinatrice au service Démocratie
Le livre : vecteur d’émancipation et/ou objet de distinction sociale ?
Témoin de l’histoire des idées, le livre en est aussi acteur dans la mesure où ce support de communication est à la fois vecteur de connaissance et producteur de sens. Qu’il suffise pour nous en convaincre de nous souvenir du rôle qu’il a joué du XVIe au XVIIIe siècle à la diffusion d’idées nouvelles, ou à l’enjeu social formidable de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture par tous, porté notamment par le combat de Jules Destrée pour asseoir l’obligation scolaire pour tous.
Vecteur de connaissances, le livre est également enjeu de pouvoir : il rend compte de relations de pouvoir. Il implique un contrat qui lie l’auteur et son lecteur à la promesse d’un sens1.
Selon les conclusions de l’étude du Centre de Lecture publique de la Communauté française (CLPCF), le capital culturel joue un grand rôle dans la pratique de la lecture. Le capital économique par contre ne constitue pas une variable prépondérante. L’âge est fondamental (les jeunes de 15 à 24 ans ont tendance à lire des BD, des magazines de loisirs et pratiquent assidûment les sms ; jusqu’à 18 ans, en relation à la scolarité, ils fréquentent occasionnellement ou ponctuellement une bibliothèque, de 24 à 44 ans, on constate une lecture importante des courriers et quotidiens …). Le sexe est une variable essentielle (les femmes lisent plus des livres de décoration, tourisme, romans sentimentaux, et les hommes, les revues techniques, les dossiers de travail, …). Les évènements qui jalonnent le parcours des individus (naissances, mariages, rencontres, etc.) ont un impact également.
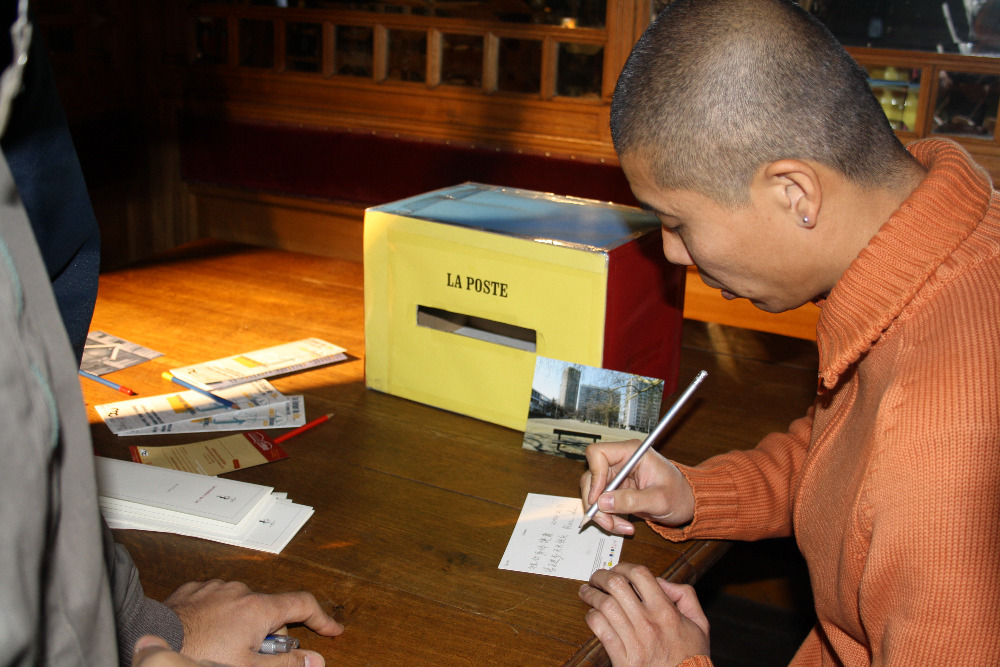
Plus fondamentalement peut- être pour notre propos, le livre existe par la pratique culturelle de la lecture. Pour comprendre une pratique culturelle, on peut former deux hypothèses préalables2. L’une qui considère que les individus choisissent librement une pratique spécifique (la lecture de tel livre, l’écoute de telle émission de radio, …), l’autre qui entend ces choix comme étant déterminés par d’autres facteurs que le seul goût personnel. Ainsi, en ce qui concerne la lecture, les goûts des lecteurs seraient le produit des conditions sociales qui les ont façonnés (habitus, capital culturel, etc.). En effet, selon l’enquête « Pratiques et attitudes face à la lecture »3, si les pratiques de lecture évoluent (démocratisation de l’enseignement, diversifications éditoriales, etc.), si des attitudes face à la lecture sont multiformes, il y a bien une corrélation entre lecture et déterminismes sociaux.
« Les pratiques de lecture traduisent une volonté de marquer son appartenance à un groupe social (auquel on s’identifie) en se distinguant clairement des autres groupes sociaux. De ces stratégies de classement naît une hiérarchie des lectures. On assiste à une diversification des pratiques de lecture, tant au niveau des supports qu’au niveau des contenus. »4
Ainsi, le livre, la lecture sont-ils surdéterminés : objet ou pratique de distinction sociale, ils ne tendent pas en soi à l’émancipation5.
Ici se joue peut-être le cœur du défi laïque d’émancipation individuelle et collective : multiplier les possibilités d’actions, de projets qui permettront aux lecteurs de passer outre la valeur d’objet symbolique de distinction sociale du livre pour en agir pleinement la valeur démocratique de compréhension du monde, de libre examen et de positionnement citoyen.
Mais ils peuvent y contribuer. Outre les pré-requis de base concernant les capacités langagières de lecture et d’écriture, il faudra travailler l’écart symbolique entre le lecteur potentiel et le livre, la lecture ainsi que les lieux par excellence qui sont voués au contact avec le livre : la bibliothèque et la librairie.
Ici se joue peut-être le cœur du défi laïque d’émancipation individuelle et collective : multiplier les possibilités d’actions, de projets qui permettront aux lecteurs de passer outre la valeur d’objet symbolique de distinction sociale du livre pour en agir pleinement la valeur démocratique de compréhension du monde, de libre examen et de positionnement citoyen.
- G. Steiner, « Le Silence des Livres », pp. 11- 12, Seuil, 2007. L’auteur complète son propos par une analyse peu commune du rapport de l’écrit et de l’oralité à la démocratie.
- L’étude sur « Les pratiques et consommations culturelles en Communauté française. Un état des lieux. Rapport final mai 2006 » tente d’approcher la question en fonction de variables quantitatives et qualitatives afin de tenir compte des facteurs déterminants tels que la classe sociale et des facteurs plus individuels.
- In – Les cahiers du CLPCF, décembre 2002. Cette étude relève notamment quelques points assez remarquables pour cerner les pratiques de lecture en communauté française. En voici certains particulièrement évocateurs : Si on hiérarchise le temps consacré aux loisirs on constate que l’activité de loisir principale du belge moyen (de 15 ans et plus) est la télévision (3h/j), suivie de la radio (2h/j), des activités sociales (voir des parents, amis, … 34'/j). La lecture vient en 8e position avec une moyenne de 8 minutes.
- Op. cit, p. 8.
- Dans ce même ordre d’idée, A Desharte souligne que « Les historiens rappellent que le raffinement d’une civilisation et son rapport privilégié à l’art n’a jamais empêché le triomphe de la barbarie, qu’on ne peut espérer des livres qu’ils changent le monde. A. Desharthe, « Pourquoi développer le goût de la lecture ? », in – « L’avenir du livre », colloque, février 2007, p 32.