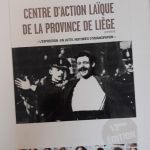-
 Jonathan Piron,
Jonathan Piron,
coordinateur du Centre de recherche et d’étude politique (CREP)
la réhabilitation des communs ?
Face aux agressions de l’économie néolibérale, nombreux sont les projets qui éclosent en vue de protéger les ressources et d’envisager une redistribution non basée sur le profit. La critique du marché n’est cependant pas une des seules motivations de certains de ces mouvements. Face à un État lui-même guidé par des logiques de rentabilité ou par une bureaucratie étouffant les communautés, des « institutions » en viennent à se développer pour redonner plus de capacités aux communautés locales. Certaines de ces dernières, sans parfois même le savoir, se retrouvent dans la sphère des Communs1.
Déjà, un Commun doit s’entendre autour du « vivre ensemble » et de la capacité qu’ont les citoyens à s’organiser entre eux, pour produire du social, de l’économique, du politique, sans entrer dans des logiques de concurrence ou d’accaparement.
Ensuite, un Commun peut aussi s’entendre comme forme d’action politique d’une communauté afin de défendre ses intérêts. À Naples, des actions collectives ont permis d’éviter la privatisation de la société publique chargée de la distribution de l’eau et d’assurer sa transformation suivant un mode de gestion « citoyen » fonctionnant suivant les principes du Commun. Dans d’autres endroits, des communautés développent des projets sociaux et économiques touchant un territoire plus large qu’une échelle micro-locale, comme à Liège avec la Ceinture Aliment-Terre Liégeoise (voir ci-dessous) ou EnerGent à Gand, initiative dans laquelle des familles cotisent pour la construction d’éoliennes le long de l’autoroute E40.
Les Communs proposent, ainsi, une alternative qui redonne aux « gens » les moyens d’action et de décision. Ils favorisent également les échanges, la confrontation, le partage, le règlement des conflits. Face à des situations potentiellement déstabilisatrices, un Commun, correctement formé, pourrait dégager les moyens pacifiques de stabiliser une crise frappant une communauté déterminée.
Pour y arriver, l’importance de l’autonomie est cruciale. Un Commun ne s’impose pas. Il part d’une base existante, d’un terreau social favorable qui souhaite aller plus loin et devenir « institution ». Sa reconnaissance permet aussi une révolution.
Car la mise sur pied d’une société des Communs amène, in fine, une transformation des sphères existantes du marché et de l’État et un équilibre de ces deux mondes avec la sphère autonome des Communs. Le rôle de l’État reste cependant crucial. Sans ce dernier, ces projets autonomes seraient condamnés à ne rester actifs qu’au niveau local, dans des niches réservées à certaines catégories socio-professionnelles. Mais ce nouvel État doit devenir un partenaire, via notamment l’établissement nouveau de partenariats publics-Communs. Pousser plus loin et généraliser ces logiques sont les voies à suivre pour enclencher une réelle transformation.
- Selon Boiler David, un Commun est une ressource partagée, gérée, et maintenue collectivement par une communauté ; celle-ci établit des règles dans le but de préserver et pérenniser cette ressource tout en fournissant la possibilité le droit de l'utiliser par tous.