-
Anne Fivé,
directrice juridique du Centre d’Action laïque
LE REPORT DU DÉBAT PARLEMENTAIRE SUR LA PROPOSITION DE LOI MAHOUX, DEFRAIGNE ET CONSORTS SUR LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT. UNE ERREUR D’APPRÉCIATION ?
Il ne se passe pas un jour sans que les médias n’évoquent les tensions qui existent entre la religion et le politique tant en Belgique, en Europe que dans le monde. Quelques exemples récents en sont la démonstration : la décision prise par des femmes politiques d’extérioriser leur appartenance religieuse, le débat lancé, à défaut de discussions au niveau national, par la très consensuelle Ville de Namur sur l’extériorisation des signes d’appartenance religieuse par les agents communaux et dans les écoles de la ville, l’affaire des crucifix dans les écoles publiques italiennes1 ou encore la demande des évêques espagnols d’annulation immédiate de la toute nouvelle loi espagnole sur l’interruption de grossesse, comparée par ces derniers à un « permis de tuer des enfants ».
Cette résurgence du religieux allant jusqu’à vouloir faire primer certains prescrits religieux sur nos lois n’est pas un phénomène nouveau. Conscient de cette évolution préoccupante, le Conseil Central Laïque a soutenu activement, depuis plusieurs années, la proposition de loi « visant à appliquer la séparation de l’état et des organisations et communautés religieuses et philosophiques non confessionnelles », en d’autres mots à affirmer de manière explicite la neutralité de l’état fédéral. La proposition de loi fut d’abord déposée par Pierre Galand en 2007 et ensuite redéposée par les sénateurs Mahoux, Defraigne et consorts. Cette proposition, rappelons-le, n’a rien de révolutionnaire. Elle énonce cinq règles élémentaires d’organisation de l’état fédéral qu’il conviendrait d’étendre aux entités fédérées, à savoir que la loi civile a la primauté sur les prescrits religieux2, les cérémonies publiques officielles organisées par l’état fédéral doivent être exemptes de toute référence à une conception religieuse ou philosophique (exit par exemple les Te Deum officiels), l’ordre protocolaire doit donner la préséance aux corps constitués et aux autorités civiles et les représentants des cultes et philosophies non confessionnelles ont un même rang protocolaire, les bâtiments publics fédéraux doivent être neutres sauf bien entendu lorsqu’il s’agit d’un musée ou d’une exposition et les agents de la fonction publique fédérale ne peuvent afficher, dans l’exercice de leurs fonctions, une quelconque manifestation extérieure de toute appartenance philosophique, religieuse, communautaire ou partisane.
Elle vient pourtant de connaître un bien triste sort. Le sénat a décidé, fin 2009, de ne pas entamer le débat parlementaire sur son contenu et de reporter son examen sine die, par suite d’un blocage politique émanant principalement du CD&V et du CDH.
Séparer le religieux du politique ne semble manifestement plus dans l’air du temps pour certains parlementaires voire dérangeant…
Or, comme nous nous plaisons à le lire dans le récent article rédigé par Vincent de Coorebyter3, notre Constitution belge « est profondément républicaine dans son organisation générale, (…). Elle radicalise la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en professant que « Tous les pouvoirs émanent de la nation », ce qui exclut toute source divine, et en ajoutant qu’ils « sont exercés de la manière établie par la Constitution », laquelle n’autorise aucune forme d’immixtion du religieux dans le fonctionnement de la vie politique ou dans l’organisation de l’état. »
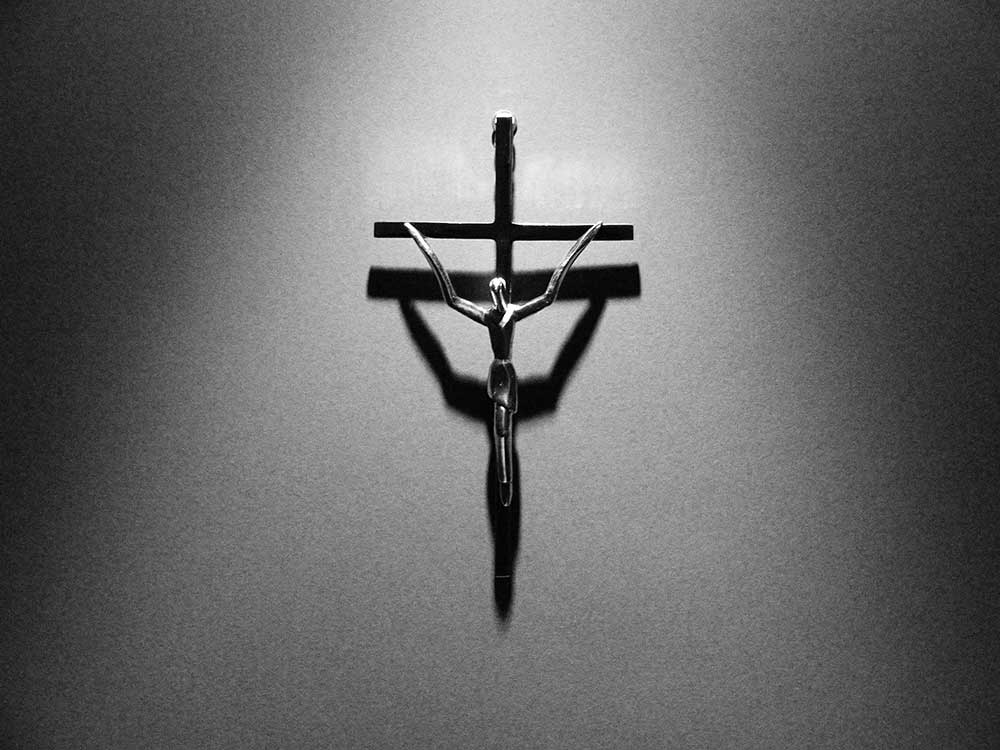
La proposition de loi Mahoux, Defraigne et consorts n’a, à notre sens, pas d‘autre objectif que de supprimer toute forme d’immixtion du religieux dans l’organisation de l’état fédéral.
Tout en reconnaissant l’importance dans nos sociétés du droit à la différence et à la diversité, si l’on veut mieux vivre ensemble demain, nous pensons qu’il est urgent de définir, pour les institutions et services publics ainsi que pour les écoles, la ligne de partage entre le religieux et le politique4, garantissant ainsi au passage leur impartialité et une réelle égalité entre les religions.
Cela ne signifie évidemment pas que ces règles de stricte neutralité des institutions publiques soient transposables ipso facto dans l’espace public (la rue, les entreprises, etc). C’est, à notre sens, la seule voie qui permette, dans le respect des acquis de la démocratie, de maintenir la paix sociale, de garantir la liberté de conscience et de religion, l’apprentissage de la citoyenneté tout en tendant vers plus d’égalité et d’émancipation pour chacun.
- La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) vient d’accepter d’examiner en appel un recours de l’Italie qui avait été condamnée pour la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques, dans le cadre de l’affaire Lautsi contre Italie
- Concrètement, cela implique par exemple qu’un médecin puisse sans discussion possible faire prévaloir l’obligation d’assistance à personne en danger visée par l’article 422bis du Code pénal même en cas de déclaration de volonté écrite d’un témoin de Jéhovah s’opposant à toute transfusion sanguine.
- Retour sur une confession par Vincent de Coorebyter, Directeur général du Centre de recherche et d’information socio-politiques (Crisp), publié dans le journal Le soir du mardi 2 mars 2010, p. 17
- idem
