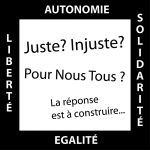-
Joseph Licata
-
Marc Vandewynckele
Participer, oui. Mais comment ?
Quelle est la place du monde associatif dans des processus participatifs ? Quels sont les acteurs concernés par ce type de processus ? Des habitants d’un quartier, des élus, des acteurs socio-économiques, des techniciens… ? Quels sont les outils qui permettent l’émergence d’un processus participatif ? Voilà bien des questions qui se posent quand on parle d’associer les habitants à la vie collective d’une ville, d’un quartier, et du rôle que peuvent jouer les associations.
Depuis quelques décennies, plu sieurs méthodologies tentent de mettre en œuvre de telles approches, dont notamment la recherche-action participative élaborée par Ita Gassel, ethnologue belge décédé en 1994. En quelques mots, la recherche-action participative envisage le groupe humain (composé lui-même de plusieurs groupes sociaux concrets) dans son contexte. L’écoute et l’observation de ces différents groupes sociaux ont pour but de produire des actions de changements par rapport aux difficultés exprimées. Les thèses, les arguments de chaque groupe social sont de ce fait le contenu d’une expertise partagée dans la perspective d’un maître plan.
Avec Ita Gassel, la recherche-action participative est davantage une philosophie d’action, un processus au cours duquel les groupes sociaux vont progressivement gagner une maîtrise sur leur histoire et leur territoire.
En résumé, ce processus sera articulé autour de quatre moments : l’émergence, l’expertise, la mobilisation et la stratégie.
Avec Ita Gassel, la recherche-action participative est davantage une philosophie d’action, un processus au cours duquel les groupes sociaux vont progressivement gagner une maîtrise sur leur histoire et leur territoire.
L’émergence
Pendant ce moment, chez les individus et les groupes sociaux concrets sont enfouis des ressources considérables, des potentiels, des passions. Les problèmes ne sont pas niés, mais ils sont observés à partir des forces détectées que nous considérons comme contrariées et qu’il s’agit de libérer.
L’expertise
Les individus et groupes sociaux concrets que nous rencontrons y ont une vision du passé, du présent et de l’avenir et, de manière latente, une capacité de comprendre les situations et à proposer des trans- formations adaptées. Cette écoute participative est la base de débats démocratiques de plus en plus élargis.
La mobilisation
Les individus et les groupes sociaux concrets redevenus auteurs, concepteurs, et acteurs, dépassent progressivement leur intérêt particulier pour entrer dans l’intérêt général. Des micro-projets émergent et sont accompagnés. Ils s’inscrivent petit à petit dans un projet global qui leur est devenu familier.
La stratégie
Ayant détecté les énergies disponibles, capitalisé l’expertise au-delà de celle des techniciens et déclenché la mobilisation, il est alors possible de situer chacun dans son rôle suivant le principe de subsidiarité et de produire de nouvelles formes de coopération d’un projet bien identifié.
Au fil des années, ce type de processus s’est toutefois vu contrarier par une atomisation du tissu social. En effet, ce n’est qu’actuellement que nous ressentons le virage opéré à la fin des années 1970 (opéré d’abord dans les pays anglo-saxons) avec le choix d’une société néo-libérale, régie par des relations singulières entre l’individu et son environnement. Comme si le monde n’était plus qu’un assemblage d’entité unique avec pour objectif l’affirmation de soi. D’une manière significative, le sentiment d’appartenance à un groupe social s’est dilué en un rapport de force entre des intérêts privés.
Pour rappel, l’activité humaine de nos sociétés s’organise autour d’un certain nombre de sphères plus ou moins hermétiques or, la sphère associative et les corps intermédiaires (ayant comme fonction d’être un lien entre la population et les aires de décision, qu’elles soient publiques ou socio-économiques) se sont graduellement dégradés. Cette lourde tendance, renforcée par un repli sur soi dans un contexte économique morose, a transformé durablement l’activité humaine désintéressée en activité humaine de loisir et de consommation, où l’hédonisme et l’individualisme sont considérés comme valeurs premières.
Paradoxalement, les pouvoirs publics proclament une nouvelle culture politique : écoute du citoyen, politique de proximité, promotion de la citoyenneté, à l’instar d’expériences menées dans des pays d’Amérique Latine comme le budget participatif. C’est ainsi que la sphère publique et politique tente de mettre en œuvre aujourd’hui, des programmes participatifs, à travers notamment des Projets de Ville. Cependant, le plus souvent, la sphère publique et politique s’adresse directement à l’habitant ; elle lui demande d’exprimer ses besoins en tenant compte de l’intérêt général tout comme bon citoyen qui se respecte. Mais, elle fait l’impasse d’une expertise partagée et d’une délibération avant de prendre une décision, et met de côté la sphère associative comme intermédiaire.
Dans cette démarche, nous observons souvent ce type de cheminement :
La rencontre entre l’élu et les habitants se fera en direct, en face à face, sur un sujet local étranger aux enjeux socio-économiques (aménagement de quartier, problème de sécurité, problème de propreté, …).
Les échanges feront plutôt émerger les aspects négatifs du sujet pour lequel la participation de l’habitant est demandée.
L’élu aura tendance à vouloir régler tous les besoins exprimés par l’assistance en tenant des promesses qui seront difficiles à mettre en œuvre.
L’habitant-individu face à un constat d’immobilisme (les engagements pris par la sphère publique se faisant attendre) aura de la méfiance, de la lassitude, un scepticisme envers toutes démarches participatives. Et lors de consultation citoyenne, l’espace de débat sera noyauté par un public ayant davantage une attitude NIMBy (not in my back yard) qu’une attitude constructive et d’ouverture vers l’autre.

Dans ce nouveau contexte, quel est l’usage fait de l’espace public (lieu intermédiaire qui rend possible la rencontre de groupes sociaux différents, l’échange de points de vue, la délibération en vue d’une décision concernant la vie de la Cité) ? En effet, aujourd’hui, l’espace public est davantage perçu comme une forteresse à conquérir (ou à défendre, à occuper), avec pour corollaire une communication sur le mode de la confrontation. Face à cette réalité, la volonté de s’appuyer sur la culture vécue et de construire avec les différents acteurs concernés des espaces de rencontre, de réflexion et de débat pour se comprendre avant de programmer, nous a amené à relever de nouveaux défis.
Il faut développer des pratiques de démocratie délibératives en constituant les habitants en co-auteurs – concepteurs – acteurs – évaluateurs des projets de territoire et en développant leur niveau de conscience politique.
Il est nécessaire de reconstituer une subsidiarité active à partir de l’identification des besoins dans la sphère privée pour les faire venir dans l’espace public, comme base d’un nouveau contrat social.
Il est aussi essentiel de faire renaître un mouvement social, opposé à l’orgueil de l’action technique et administrative.
Il faut permettre au politique de donner le sens : un mailleur plus qu’un commissaire.
Il est utile de promouvoir une économie de pleine activité dans une vision dynamique et productive de la sphère socio-économique.
Récusant toute stigmatisation ou enfermement de groupe social, de classe d’âge, de culture ou de territoire, il faut redonner une place centrale dans la recomposition du tout : faire du transfrontalier (un passeur et un non douanier armé).
Nous devons, dès lors, passer pédagogiquement du local au global et du présent aux générations futures.
< Retour au sommaire