-
 Jean Heutte,
Jean Heutte,
maître de conférence à l’université de Lille et spécialiste francophone du flow
Le flow : la satisfaction d’accomplir
Jean Heutte est maître de conférences au sein de l’équipe Trigone-CIREL de l’université de Lille. Il est l’un des chercheurs référents au niveau européen de la modélisation théorique de l’expérience optimale, ou flow.
Salut & Fraternité : Vos travaux s’intéressent au phénomène du flow. Qu’est-ce que c’est ?
Jean Heutte : Je vais citer la version francophone de la définition de consensus établie par le Flow Researchers Network : « un état d’épanouissement lié à une profonde implication et au sentiment d’absorption, que les personnes ressentent lorsqu’elles sont confrontées à des tâches dont les exigences sont élevées et qu’elles perçoivent que leurs compétences leur permettent de relever ces défis. » C’est le bien-être que l’on ressent quand on se dépasse et que l’on veut continuer ce que l’on fait. J’insiste sur le terme « bien-être » plutôt que « plaisir », être en accord avec soi-même plutôt que de tenter de combler quelque chose d’insatiable. On parle aussi parfois de « pic de performance » mais cela donne l’impression de ne parler qu’aux sportifs de haut niveau, alors que le phénomène est accessible à tout le monde, même débutant, et qui se produit quelle que soit l’activité : sportive, manuelle, intellectuelle…
S&F : À quoi reconnaît-on cet état ?
J.H. : Le signe le plus évident, c’est le bien-être procuré par l’activité en elle-même. Même si c’est une tâche qui vous a été assignée, le fait de souhaiter l’accomplir et de s’apercevoir dans le fil de l’action que vous pouvez atteindre l’objectif va vous procurer une vive émotion, un sentiment de bien-être. Vous prenez conscience que vous avez progressé au-delà que ce que vous pensiez possible. Ensuite, la perception du temps. Quand on est pris par l’activité, le temps passe à toute vitesse. On s’oublie dans l’activité, également : on se fiche d’être ridicule ou maladroit, de poser une question idiote pourvu que cela puisse permettre de réussir la tâche que l’on souhaite réellement accomplir. Mais le flow est un état fragile. Quand vous êtes plongé dans votre activité et que vous êtes interrompus, ce sera difficile de retrouver les conditions nécessaires pour vous y plonger à nouveau.
Même si c’est une tâche qui vous a été assignée, le fait de souhaiter l’accomplir et de s’apercevoir dans le fil de l’action que vous pouvez atteindre l’objectif va vous procurer une vive émotion, un sentiment de bien-être.
S&F : Justement, pour retrouver cet état de flow, le provoquer, comment faire ?
J.H. : La première chose, c’est de penser que même si elle est difficile, l’activité peut être réalisable, sinon on sera inquiet ou angoissé. Mais il faut aussi que cette activité offre du défi, sinon on se lasse. C’est pour ça qu’on parle d’expérience optimale : c’est un équilibre entre vos compétences et l’exigence de la tâche. Il faut pouvoir se concentrer, également, ne pas être distrait. Pour se plonger dans une activité il faut aussi que l’on sache où l’on va, et que l’on ait des critères clairs de réussite ou d’échec. Et durant l’activité, il faut enfin qu’on sache très vite si on est sur la bonne voie ou si on se trompe, qu’il y ait un feedback immédiat.
S&F : Quels sont les rapports entre stress et motivation ?
J.H. : Ils sont complexes. Le stress est une réponse à deux nécessités vitales : « fuir ou combattre ». À la base, c’est une réaction réflexe pour assurer sa survie. C’est un état absolument nécessaire dans certains contextes, qui concentre toutes les ressources corporelles disponibles pour agir dans l’urgence. Mais le stress est peu favorable à la cognition. En état de stress, certaines zones du cerveau sont court-circuitées, ce qui va notamment impacter notre réflexion, notre mémoire, même notre jugement éthique. Ce n’est pas la meilleure idée de mettre en état de stress quelqu’un qui doit réfléchir, apprendre, prendre des décisions nuancées…
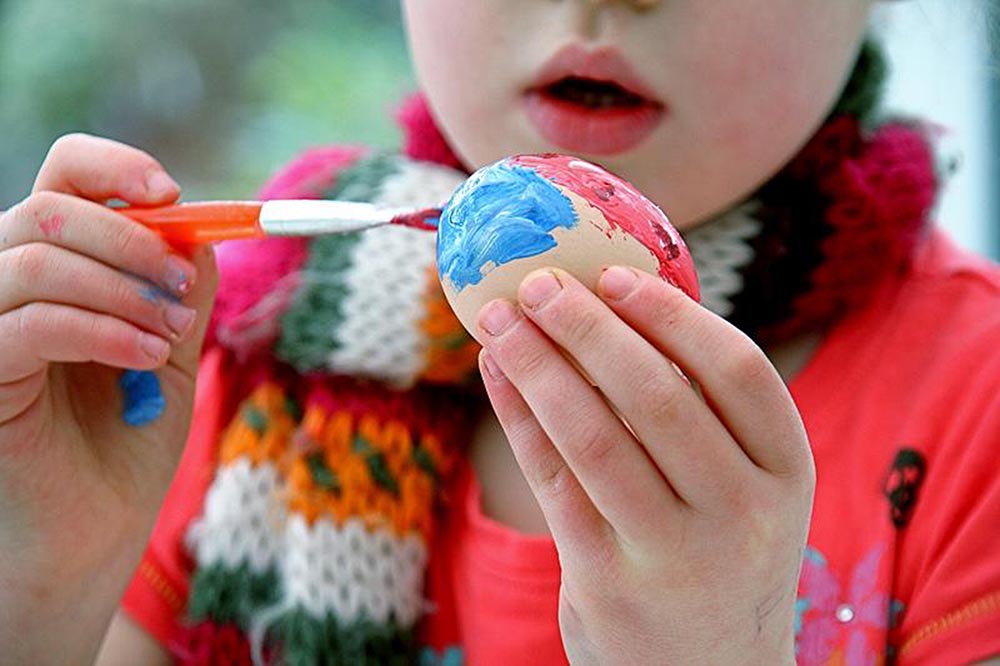
S&F : Le flow, c’est le bonheur au travail ?
J.H. : C’est le bien-être dans la réalisation d’une tâche précise. Quand les conditions sont réunies, en progressant dans la tâche, je progresse aussi moi-même dans ma pratique. Je vis ce moment où ma pensée, mes gestes, ma tâche se réalisent sans aucune difficulté. Cette impression de grande fluidité, c’est le flow qui s’exprime. Et contre toute attente, c’est au travail que la plupart des gens perçoivent le plus souvent le flow. Ce « paradoxe du travail » a été mis en évidence dès 1989 dans une étude conduite par Mihály Csíkszentmihályi, le chercheur à l’origine de la notion de flow, et Judith LeFevre. L’inaction nous fait ruminer, et ruminer provoque de l’anxiété. Être actif, même dans des tâches que l’on n’a pas choisies, augmente les chances que l’une d’entre elles nous mène vers le flow.
Pour aller plus loin :
- Heutte, J., (2017). « L’environnement optimal d’apprentissage tout au long et tout au large de la vie : Contribution de la recherche empirique sur les déterminants psychologiques de l’expérience positive subjective aux sciences de l’éducation et de la formation des adultes ». Sciences & Bonheur, 2. ISSN : 2448–244X https://goo.gl/xghTCq

