-
 Jean-Jacques Jespers,
Jean-Jacques Jespers,
journaliste et professeur à l’Université Libre de Bruxelles
Médias et libre examen : entre passion et prudence
Jean-Jacques Jespers est journaliste et professeur de journalisme à l’Université Libre de Bruxelles. Il nous parle des rapports difficiles entre médias et libre examen.
Salut & Fraternité : Comment s’informer de façon critique ?
Jean-Jacques Jespers : Un de mes professeurs disait : « s’informer fatigue ». Bien s’informer, c’est s’armer de patience et d’énergie. Il faut consommer l’information avec passion et prudence, s’abreuver à toutes les sources disponibles, les comparer, les mettre en rapport les unes avec les autres. S’informer, c’est faire l’examen critique de ce que nous offrent les médias, et pas seulement les médias établis. C’est un véritable travail à temps plein ! Évidemment, la plupart des citoyens sont trop occupés : faire ce travail est hors de leurs moyens. Un des rôles du journaliste est de lui préparer le terrain, de faire un travail préalable de comparaison et de sélection de l’information, de préciser le contexte. Malheureusement, de nos jours, un journal doit chasser le scoop pour rester à flot, être le premier sur le sujet ou surenchérir sur ses collègues : ça laisse peu de temps au reste. C’est moins la faute des journalistes que celle des structures de diffusion qui veulent rentabiliser à outrance.
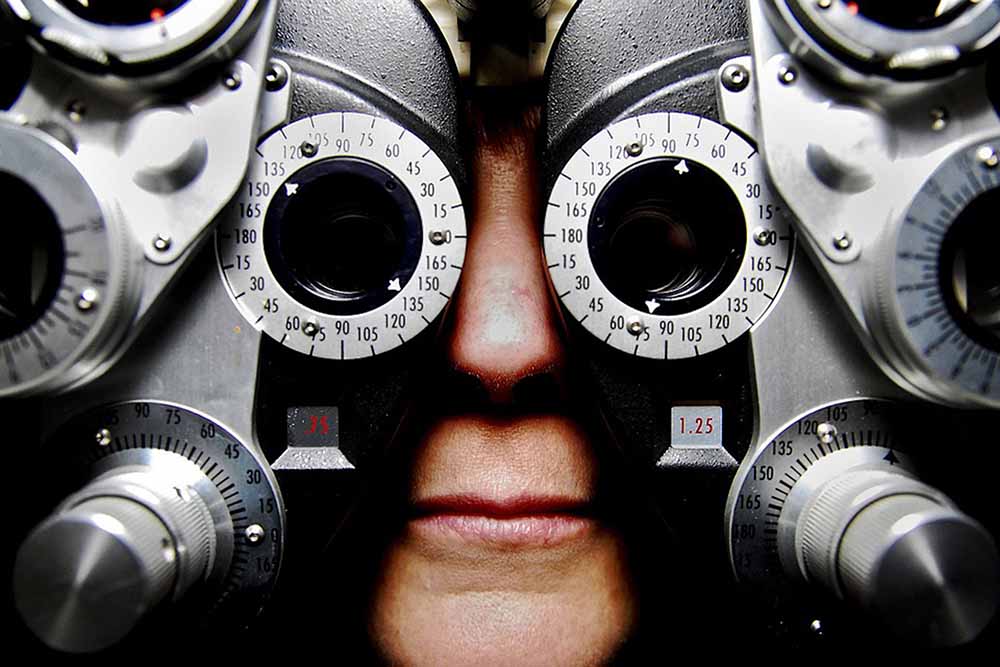
S&F : Vous parliez de sortir des médias établis : parlez-vous d’internet ?
J.-J.J. : Il y a toujours eu des médias plus confidentiels ou aux spectres d’intérêt plutôt spécifiques. Mais internet est une sorte de prodige pour ce type de médias. C’est un outil qui permet d’aller très loin dans la recherche et la comparaison de sources d’information. Mais internet, c’est le pire comme le meilleur : on y trouve des choses intéressantes mais beaucoup de scories également.
Ces réseaux sociaux ont intérêt à ce qu’on s’y sente bien, « chez soi », afin qu’on y revienne. Ils trient les informations et nous proposent celles qui nous conviennent, qui nous plaisent, nous touchent ou nous révoltent, que l’on va partager à notre tour vers nos amis. La visibilité de ces nouvelles dépend de ces échanges, bien plus qu’avant.
Internet change également la façon dont nous nous informons. Avec les réseaux sociaux notamment, les nouvelles circulent de façon plus horizontale, surtout chez les 15–25 ans. Ces réseaux sociaux ont intérêt à ce qu’on s’y sente bien, « chez soi », afin qu’on y revienne. Ils trient les informations et nous proposent celles qui nous conviennent, qui nous plaisent, nous touchent ou nous révoltent, que l’on va partager à notre tour vers nos amis. La visibilité de ces nouvelles dépend de ces échanges, bien plus qu’avant. Et celles-ci proviennent de journaux qui ont besoin de ce partage pour vivre. Par conséquent, les « news » qui circulent sont insolites, ou choquantes, ou au contraire rassurantes… mais pas très intéressantes.
S&F : Quelles sont les conséquences de cette horizontalisation de l’information ?
J.-J.J. : Aujourd’hui le public fait plus confiance aux pairs qu’aux experts. Quand l’information vient d’en haut, d’une position d’autorité qui peut la manipuler, le public a tendance à se méfier. Quand elle provient d’un ami ou d’un collègue, l’information semble moins manipulée. Mais c’est illusoire : non seulement elle vient d’on ne sait où et est traitée on ne sait comment, mais les risques de manipulations volontaires sont toujours présents. Et ces informations fausses voire malhonnêtes peuvent faire boule de neige ! Quand elles plaisent ou indignent, on les retrouve ensuite partout, sans que personne ne les ait vérifiées.
S&F : Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui cherche à s’informer en exerçant son libre examen ?
J.-J.J. : Exercez votre esprit critique à tous égards, pas seulement envers les médias traditionnels. À qui appartient cet organe de diffusion ? Quels sont ses intérêts ? À qui peut servir l’information diffusée ? Est-ce que les thèses développées ne privilégient pas tel courant, tel parti, telle entreprise, tel pays par rapport aux autres ? Comparez, également. La pratique du libre examen est hostile à tout dogmatisme, toute vérité unilatérale. Multiplier les sources et les questionner, c’est fondamental. C’est également valable pour les sources que vous appréciez !
La pratique du libre examen est hostile à tout dogmatisme, toute vérité unilatérale. Multiplier les sources et les questionner, c’est fondamental. C’est également valable pour les sources que vous appréciez !
Ces questions sont à se poser tant pour les médias classiques que non-traditionnels, qui ne sont pas dépourvu de stratégie et de volonté de promotion. C’est légitime de se méfier a priori des médias traditionnels mais faut-il sombrer dans une confiance aveugle envers les médias alternatifs ? Je ne pense pas. Avec une rédaction traditionnelle, il est possible de savoir quels sont les intérêts qui la finance, quelle est sa ligne éditoriale, comment elle cherche à faire de l’audience, du tirage, du clic. Un site d’information alternatif ou un blog indépendant, c’est tout autre chose. Que veulent-ils ? Promouvoir une idéologie ? Un parti ? Une société privée ? Il vaut mieux redoubler de prudence, exercer une méfiance constructive.
< Retour au sommaire
