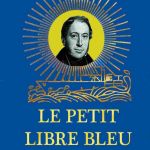-
 Claude Javeau,
Claude Javeau,
professeur émérite de sociologie de l’Université Libre de Bruxelles, essayiste et écrivain
Le libre examen face au retour de la religiosité
Claude Javeau a enseigné la sociologie à l’Université Libre de Bruxelles et est l’auteur de nombreux essais. Il nous parle du libre examen, de ses enjeux mais aussi du rôle que doit jouer la laïcité.
Salut & Fraternité : Quelle est votre définition du libre examen ?
Claude Javeau : C’est la recherche de la vérité par la raison, dont le principal instrument est la science. C’est une démarche personnelle de rejet du dogme, de toute vérité révélée.
Les églises, les mosquées et les synagogues ne sont pas remplies, mais le fait religieux menace la démarche libre exaministe. Affirmer sa confiance en la science, c’est risquer de passer pour quelqu’un de rétrograde, et d’être taxé de « laïcard », qui est un terme péjoratif.
S&F : Quels sont les enjeux du libre examen aujourd’hui ?
C.J. : Nous assistons actuellement à un retour de la religiosité et des enjeux politiques, sociaux et économiques qui y sont liés. Les églises, les mosquées et les synagogues ne sont pas remplies, mais le fait religieux menace la démarche libre exaministe. Affirmer sa confiance en la science, c’est risquer de passer pour quelqu’un de rétrograde, et d’être taxé de « laïcard », qui est un terme péjoratif. Il y a donc un enjeu pour la laïcité et le libre examen – dont il est la démarche fondamentale –, de lutter contre le retour du religieux. Certains étudiants m’ont déjà objecté que le libre examen est une démarche dogmatique comme les autres parce qu’on ne pouvait démontrer l’inexistence de Dieu. Ce qu’elle n’est pas, puisqu’elle s’appuie sur la réalité empirique. C’est donc une démarche qui s’accommode d’une variation dans le temps : ce qui est démontré aujourd’hui ne sera plus vrai dans 20 ans. Et c’est très bien comme ça. Einstein a complété Newton, Darwin ne connaissait pas la biologie moléculaire mais sa théorie de l’évolution n’en reste pas moins valable…

S&F : Que faire face à ce retour de la religiosité ?
C.J. : C’est compliqué : il faut agir sur les plans politique, idéologique et culturel. Pour le moment, un certain nombre d’intellectuels ont tendance à tout sacrifier au nom de la spécificité des cultures. Défendre la rationalité et le libre examen donne l’impression d’être une démarche ringarde sous prétexte d’un manque d’ouverture. Nous sommes sur la défensive. N’oublions pas que la Belgique est un pays de tradition catholique avec une famille royale confite en dévotion. Les interventions des évêques de l’Église dans la vie politique belge sont courantes. Or, une majorité de gens n’ont qu’une vague idée d’une transcendance mais s’en accommodent et continuent à sacrifier aux rituels fondamentaux : se marier à l’église et faire faire leur communion solennelle aux enfants parce que c’est plus « beau », par exemple. Et ça continue avec les Te Deum, les représentations religieuses dans les cérémonies de Nouvel An, etc.
Le libre examen est une position difficile qui implique la tolérance et le respect de l’autre, mais aussi une remise en question perpétuelle. Le problème de la laïcité, c’est que nous sommes trop confiants dans l’idée d’avoir gagné. La sécularisation, elle, a gagné. C’est clair. Et nous sommes un peu assis sur nos lauriers.
Le libre examen est une position difficile qui implique la tolérance et le respect de l’autre, mais aussi une remise en question perpétuelle. Le problème de la laïcité, c’est que nous sommes trop confiants dans l’idée d’avoir gagné. La sécularisation, elle, a gagné. C’est clair. Et nous sommes un peu assis sur nos lauriers. Nous n’avons pas prévu que cette religiosité allait revenir du côté de l’islam, dont l’Église catholique profite puisqu’elle se met dans la foulée. Petit à petit, il apparaît que nous devons nous battre pour conserver ce que nous pensions être un monopole et qui n’était qu’une position précaire. Des initiatives comme celles qui s’inscrivent dans le cadre de la laïcité sont une avant-garde, qui, d’un certain point de vue, sont devenue une arrière-garde : il y a des empiètements perpétuels dans l’espace des convictions de la part de systèmes religieux qui invoquent la démocratie, la liberté de culte ou de prosélytisme, et qui arrivent à réclamer du halal dans les cantines ou à empêcher des jeunes filles d’aller à la piscine. Quand j’ai commencé à avoir des étudiantes voilées, je n’ai eu aucun problème avec leur liberté de conviction mais je m’interrogeais sur le grignotement d’un espace par la religion. Une partie de l’intelligentsia s’obstine à soutenir que ce n’est pas de l’ordre du religieux : on parle du chômage, de l’exclusion. Bien sûr que ça existe ! Mais en même temps la référence est religieuse. C’est au nom de l’islam.
Cela dit, je ne pense pas que l’inscription de la laïcité dans la Constitution soit une solution.
S&F : Pourquoi ?
C.J. : La Belgique est un pays neutre même s’il est laïque dans les faits. Or la laïcité est subventionnée par l’État au même titre que sept autres cultes. En ce sens, elle s’est « ecclésialisée » : lorsqu’elle a obtenu des subsides, elle s’est donné une structure qui ressemble à celle des religions, ce qui n’est certes pas un mal. En faisant figurer la laïcité dans la Constitution, on donnerait un avantage à la laïcité organisée par rapport aux autres cultes. Je ne suis pas contre, mais il faudrait alors la nommer autrement.