-
Catherine Fallon,
ingénieur civil chimiste de formation et docteur en Sciences politiques et sociales
« Le plan Marshall est une belle illustration d’utopie mobilisatrice »
Catherine Fallon est Ingénieur civil chimiste de formation et docteur en Sciences politiques et sociales. Elle est également directrice du SPIRAL, un laboratoire de recherches qui se caractérise par une approche interdisciplinaire. Elle s’est notamment penchée sur les liens qu’entretiennent la science, la technologie et la société.
Salut & Fraternité : Comment peut-on envisager le progrès en tant qu’utopie mobilisatrice ?
Catherine Fallon : D’une manière générale, on peut dire que l’État moderne s’est construit sur la Science. Citons par exemple la découverture de la navigation du 17e siècle ou des changements en termes de santé publique aux 18e et 19e siècles… Cependant, les pires horreurs du 20e siècle ont émergé dans une société qui était parmi les plus avancées sur les plans technique et industriel. On a coutume de dire que l’utopie du progrès s’est éteinte dans les camps de concentration.
S&F : Avec votre regard de chercheuse en 2011, êtes-vous d’accord avec cette affirmation ?
CF : Non, l’utopie ne s’est pas arrêtée mais a changé de tonalité. Le progrès fait désormais l’objet d’une approche réflexive et critique. Il y a des arguments d’autorité qu’on n’accepte plus. Auparavant, les techniciens décidaient entre eux de ce qui était bon pour la société. Mais ce système de décision est de plus en plus mis sous pression. Certains cas ont montré que des cadrages alternatifs auraient permis d’anticiper des problèmes et des effets inattendus. Au Danemark, dans les années 90, la question des OGM était ainsi gérée par le Danish Board of Technology, qui a permis que, plus tard, la politique scientifique se développe avec des processus de discussion, d’ouverture.
Faire appel aux « people expertise » est très important, parce que l’homme de la rue a quelque chose à dire. Mais il doit aussi s’approprier l’innovation. Prenons le cas des éoliennes. Soit on l’impose en se disant que les gens doivent s’habituer, soit on les mobilise autour de cet objet nouveau.
S&F : Permettre le débat au sein de la société permet donc d’éviter les problèmes futurs ?
CF : Oui, mais pas seulement. Faire appel aux « people expertise » est très important, parce que l’homme de la rue a quelque chose à dire. Mais il doit aussi s’approprier l’innovation. Prenons le cas des éoliennes. Soit on l’impose en se disant que les gens doivent s’habituer, soit on les mobilise autour de cet objet nouveau. Il s’agit là d’écouter les habitants pour avoir leur avis. Par exemple, on peut développer un projet d’implantation d’éoliennes en recueillant les avis des riverains sur d’éventuels inconvénients parce que ce genre de projet les concerne directement. Autre exemple, dans le domaine de la médecine : aux États-Unis, une société américaine (Myriad Genetics) a mis au point une technique qui évalue les chances de développer un cancer du sein. Quiconque le souhaite peut faire appel à cette société et envoyer un échantillon de sang pour le faire tester. En Europe, il a été décidé d’utiliser cette découverte dans l’encadrement du système médical en y intégrant les professionnels de la santé. Ces deux régions du monde, États-Unis et Europe, vont donc cadrer cette avancée scientifique d’une manière différente. Nous avons donc une utopie mobilisatrice qui ne s’articule pas de la même manière dans deux espaces sociaux.
S&F : Pour en revenir aux relations entre politiques publiques et utopies mobilisatrices, le côté participatif joue-t-il un rôle de plus en plus crucial ?
CF : C’est en cours de transformation au niveau européen, mais il y a encore énormément de chemin à faire au niveau wallon à ce niveau-là. Pour ce qui est du financement, les fonds augmentent en Belgique, et en Wallonie particulièrement. Mais tous les chercheurs vous diront que c’est insuffisant ! D’autant plus que la compétition se situe maintenant à l’échelon mondial. D’ailleurs, le plan Marshall est une belle illustration d’utopie mobilisatrice, et ce dans les domaines de la santé – la Wallonie est parmi les meilleurs dans ce domaine -, de la mécanique, de l’alimentation et de la logistique. Ce plan affirme que la base de la croissance économique de la Région sera basée sur des produits de pointe.
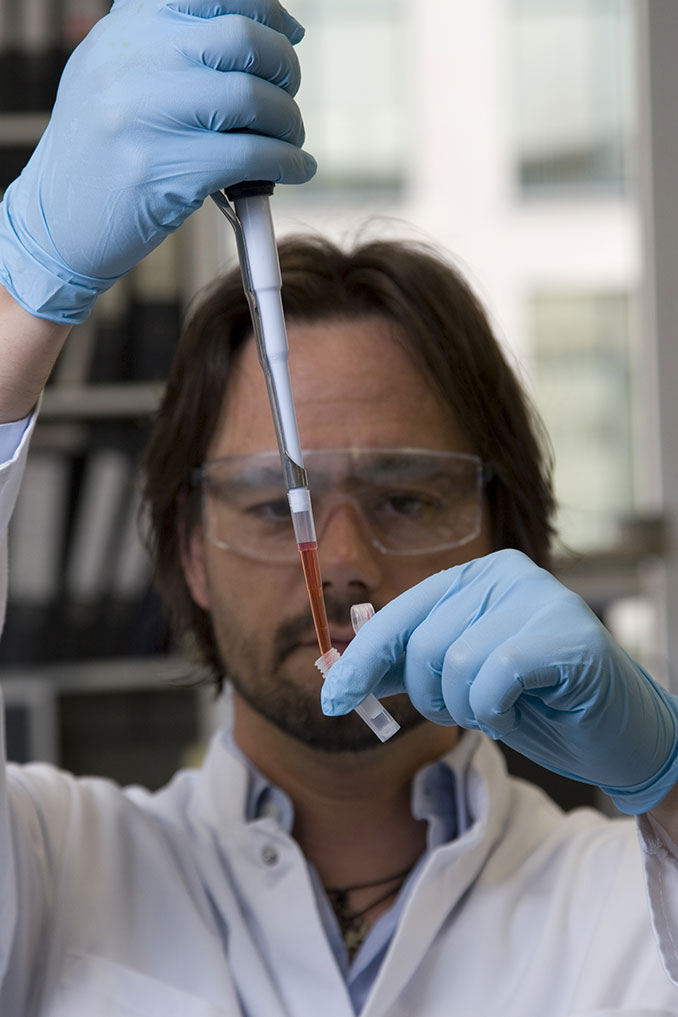
S&F : Peut-on affirmer que l’impulsion de départ de faire avancer la politique scientifique vient des citoyens ?
CF : La politique scientifique ne fait jamais vibrer les foules. Les gens veulent investir de l’argent dans la politique de santé, mais ils veulent aussi des routes, des écoles, des hôpitaux… Cette volonté vient plutôt de deux niveaux : l’Europe, puisque investir davantage dans la recherche était un élément de la stratégie de Lisbonne, et la Région wallonne, qui base son redéploiement sur le développement des sciences et des nouvelles technologies.
S&F : Comment le fruit de ces recherches va-t-il se concrétiser dans la vie quotidienne ?
CF : via des avancées techniques et via les spin-offs. À titre d’exemple on peut citer le GIGA, un laboratoire issu de l’Université de Liège qui effectue des recherches dans les domaines biomédical et vétérinaire et qui a déjà produit des vaccins pour les animaux. D’ailleurs, la Belgique est à la pointe dans le domaine de la recherche biomédicale. Nous avons des universités très compétentes dans ce domaine.
< Retour au sommaire
